Vie et mort dans la rue
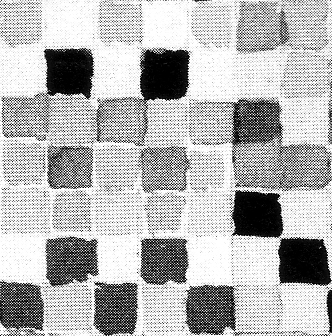 Dans le numéro précédent (n°48, avril 2008) Gérard Grancher et Jean-René Brunetière s’interrogeaient sur l’espérance de vie des SDF. Nous avons demandé leur point de vue à deux chercheurs, spécialistes de cette population.
Dans le numéro précédent (n°48, avril 2008) Gérard Grancher et Jean-René Brunetière s’interrogeaient sur l’espérance de vie des SDF. Nous avons demandé leur point de vue à deux chercheurs, spécialistes de cette population.
IL FAUDRAIT DÉJÀ SAVOIR ce que l’on entend par « sans domicile ». On n’est pas sans domicile comme on est du groupe sanguin O+, pour toute sa vie. Être sans domicile, c’est se trouver, à un moment donné, dans une situation donnée, dont on peut sortir, vers un logement, une structure collective (maison de retraite, hôpital, prison), ou par son décès. Les définitions de la situation peuvent varier selon les auteurs : pour certains, les « SDF » sont ceux qui vivent et dorment dans la rue, ou entre la rue et l’hébergement d’urgence ; pour d’autres, les sans-domicile incluent aussi ceux qui se trouvent en hébergement de longue durée, dans les appartements ou les hôtels procurés par les associations ; pour d’autres encore, il convient d’y ajouter les personnes en squat ou hébergées par un proche. Même si le passage d’un état à un autre est relativement fréquent, ces types de situation s’accompagnent d’un état de santé différent, comme le montrent les chiffres de l’enquête de l’INSEE SD2001 (de la Rochère, 2003). Outre la situation, la période de référence est elle aussi à définir : selon les auteurs, sera sans domicile celui qui se sera trouvé dans cette situation la nuit précédente, toutes les nuits du mois précédent, la majeure partie de ces nuits…
Mesurer, comme le préconise Gérard Grancher, le « taux de décès des SDF », cela peut correspondre à mesurer les décès de ceux qui sont actuellement sans domicile, avec une définition à préciser, comme on vient de le voir ; mais on peut aussi regarder en quoi le fait d’être passé par une situation sans-domicile conduit à un décès précoce, même si on a entre-temps retrouvé un logement. Techniquement, cela pourrait s’observer (avec l’accord de la CNIL) en prenant le numéro d’identification (le « numéro de Sécurité sociale »), du moins pour ceux qui en ont un, à l’occasion d’une enquête comme celle qui a eu lieu en 2001 ; et en regardant au fil du temps quand les décès ont lieu, à partir des données d’état civil. Humainement, nous ne nous voyons pas expliquer aux enquêtés qu’on leur demande leur numéro de Sécurité sociale pour savoir quand ils vont mourir. Et cela risquerait de rendre la relation d’enquête un peu… froide, si on peut oser ce mot.
À l’étranger, cette méthode a été employée à plusieurs reprises dans le champ réduit des usagers d’un service destiné aux sans-domicile. Il s’agit de suivre une cohorte de personnes ayant séjourné dans des centres d’hébergement d’une ville durant une certaine période et de repérer, quelques années plus tard, les individus décédés à partir des fichiers d’état civil (Barrow et al., 1999 ; Cheung & Hwang, 2004 ; Hwang, 2000 ; Nordentoft & Wandall-Holm, 2003 ; Roy et al., 2007).
Des chercheurs comme Daniel Terrolle (Terrolle, 2002) s’intéressent, eux, aux décès qui ont lieu dans la rue, soit une partie seulement de ceux évoqués ci-dessus. En particulier, il est favorable à une exploitation des bulletins remplis à la morgue, où sont conduits les corps des personnes décédées dans la rue. Mais, outre que cela ne donne pas d’indication sur les décès à l’hôpital des sans-domicile qui y ont été transportés juste avant leur mort, l’étude de la façon dont sont remplis les bulletins de décès laisse à penser que leur exploitation pour dénombrer les sans-domicile morts sur la voie publique ne serait pas très éclairante.
Le bulletin de décès rempli par les officiers d’état civil donne quelques indications sur le domicile de la personne (commune et département ou pays) et le lieu de décès (dont la modalité : voie ou lieu public). On pourrait penser que le croisement « domicile inconnu » et « mort sur la voie publique » répondrait à la question. Mais il n’en est pas ainsi. D’une part, les personnes décédées sur la voie publique et dont l’identité n’a pu être établie (donc le domicile non déterminé) ne sont pas nécessairement sans domicile. D’autre part, les pratiques des officiers d’état civil ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire ; toutefois, il semble que la pratique dominante, lorsque le domicile n’est pas connu, soit de mettre en commune de domicile celle du décès. De plus, en ce qui concerne les sans-domicile, certaines pratiques existent : si le sans-domicile a sur lui des papiers, par exemple une carte d’identité, l’adresse qui y figure (celle d’un domicile occupé à un moment de son passé) sera utilisée pour coder la commune de domicile ; ou la personne sans domicile peut être rattachée au centre d’hébergement auquel elle faisait appel, et c’est la commune du centre qui sera utilisée. Il faudrait donc un gros travail d’homogénéisation des pratiques avant de pouvoir utiliser des informations provenant des morgues.
Par ailleurs, Daniel Terrolle écrit que 94 % des SDF disparaissent et que la majorité meurt dans la rue. Son pessimisme s’explique en partie par son terrain d’enquête : Daniel Terrolle travaille surtout auprès des personnes qui sont depuis longtemps à la rue, celles dont la santé est le plus affectée, comme le montre l’enquête SD2001. De plus, les méthodes ethnographiques tendent à occulter les séjours courts dans une situation, puisque les liens étroits qui se tissent avec les personnes observées n’ont pas le temps de se nouer avec des personnes qui ne resteront à la rue que quelques jours ou quelques semaines. L’enquête Logement 2006, qui interroge les personnes logées sur d’éventuelles périodes antérieures sans logement personnel, montre qu’au moins 250 000 personnes actuellement en vie ont retrouvé un logement après avoir connu la rue, y compris, pour certaines, pour des périodes de plus d’un an (ce qui ne veut pas dire que leurs conditions de logement actuelles soient excellentes ni leur situation financière aisée, ni qu’elles mourront à un âge avancé).
Ce chercheur élabore donc un guesstimate* dont nous lui laissons la responsabilité. Il n’en reste pas moins que l’on peut penser que le taux de décès des sans-domicile, à âge et sexe égaux, est certainement plus élevé puisque ces personnes, quand elles sont sans domicile, s’estiment davantage en mauvaise santé que les personnes logées (16% vs 3 % ; de la Rochère, 2003) et que, chez les jeunes sans domicile (16-24 ans), plus de la moitié d’entre eux déclare au moins un problème de santé (Amossé et al., 2001) ; de plus, ces personnes ont majoritairement une origine sociale modeste ce qui se traduit aussi par une moindre espérance de vie. Ainsi des chercheurs danois qui ont cherché à retrouver des sans-domicile hébergés dans un centre huit ans après cet hébergement, ont découvert que 15 % étaient décédés et ont estimé que leur taux de mortalité à âge et sexe comparables était treize fois plus élevé qu’en population générale (Stax, 2004). Dans le cas d’une autre enquête danoise analogue, les chercheurs ont montré que près de la moitié des personnes décédées étaient mortes dans un nouveau logement et seulement un quart dans la rue (Nordentoft & Wandall-Holm, 2003).
Il reste cependant plusieurs difficultés dans l’interprétation de ces chiffres. Tout d’abord, une partie des sans-domicile ne fréquente que rarement les centres d’hébergement (base de sondage des enquêtes citées), alors que ce sont ceux qui, vivant dans l’espace public, ont la plus mauvaise santé. En second lieu, si on veut comparer les taux de décès des sans-domicile avec ceux de la population logée, ne faudrait-il pas aussi tenir compte de leur origine sociale ?
Malgré les difficultés méthodologiques, il est donc important d’avancer dans la connaissance de cette forme d’injustice sociale.
Quant à savoir si « personne ne veut voir quantifier » ce problème, aucun élément objectif ne nous semble permettre d’avancer cet argument. On peut dire, en revanche, que si de façon conjoncturelle il peut y avoir une forte demande de chiffres sur les sans-domicile (et tout particulièrement sur ceux qui vivent dans la rue), à l’occasion de telle ou telle crise répercutée par les médias, c’est le travail quantitatif de long terme sur ce thème qui a du mal à se faire une place. Il n’y a qu’à compter le faible nombre de personnes, que ce soit au CNRS, à l’INED ou à l’INSEE, dont la fonction actuelle est de travailler quantitativement sur la question des sans-domicile…
Maryse Marpsat et Jean-Marie Firdion
*Ndlr : Estimation « au doigt mouillé »
Références :
Amossé T., Doussin A., Firdion J.M., Marpsat M., Rochereau T., 2001, “Vie et santé des jeunes sans domicile ou en situation précaire”, Questions d’économie de la santé, n°40.
Barrow S.M., Herman D.B., Cordova P., Struening E.L., 1999, “Mortality among homeless shelter residents in New York City”, American Journal of Public Health, 89:529-534.
Cheung A.M., Hwang S.W., 2004 “Risk of death among homeless women : a cohort study and review of the literature”, Canadian Medical Association Journal, 170(8):1243-1247.
de la Rochère B., 2003, « La santé des sans-domicile usagers des services d’aide », INSEE-Première, n°893.
Hwang S.W., 2000, “Mortality among men using homeless shelters in Toronto, Ontario”, JAMA, 283(16):2152-2157.
Nordentoft M., Wandall-Holm N., 2003 “10 year follow up study of mortality among users of hostels for homeless people in Copenhagen”, BMJ, 327(81).
Roy E., Haley N., Leclerc P., Sochanski B., Boudreau J.F., Boivin J.F., 2007, “Mortality in a Cohort of Street Youth in Montreal”, JAMA, 292(5):569-574.
Stax T. B., 2004, Possibilities and Limitations in Longitudinal Analysis of Homelessness Based on Information From Official Registers, CUHP, atelier de Copenhague, 29-30 avril. http://www.cuhp.org/admin/EditDocStore/DK_longpaper_WS3vers2.pdf.
Terrolle Daniel, 2002, “La mort des SDF à Paris : un révélateur social implacable”, Études sur la mort, n° 122 : 55-68.
Ndlr : il n’est pas d’usage dans cette Lettre de donner de nombreuses références bibliographiques. Monsieur Pescheur ayant cru bon de nous en imposer, nous montrons ici que nos auteurs n’en manquent pas non plus…